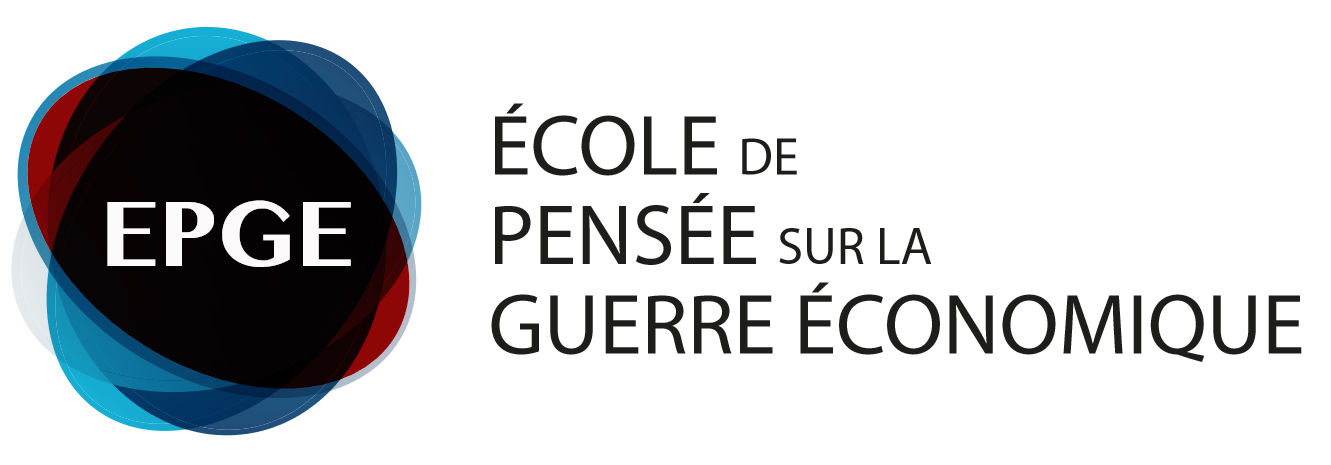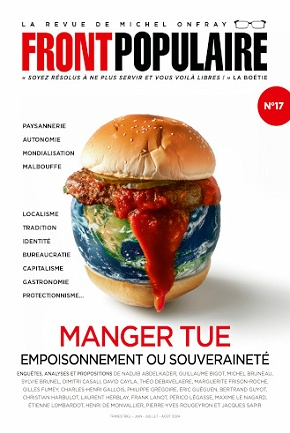
Par Christian Harbulot et Etienne Lombardot (étudiant d’AgroParisTech et membre du groupe de réflexion sur l’agriculture au sein de l’EGE).
La révolte rampante des agriculteurs français est un signal d’alarme qui aurait dû être tiré depuis longtemps. Le monde paysan est en danger pour des raisons de survie existentielle mais aussi parce que la pérennité de cette force de travail est menacée par la réduction continue du nombre d’exploitants. Si la fragilisation du monde n’affecte pour l’instant qu’à la marge les traders qui jouent un rôle croissant dans les échanges de matières premières agricoles, il n’est plus possible de faire l’impasse sur deux problématiques essentielles : les besoins vitaux d’alimentation des populations et la résilience des territoires. Ces deux problématiques relancent, à bas bruit pour l’instant, le débat sur la raison d’être de l’agriculture française.
La déqualification de l’agriculture dans les préoccupations stratégiques
L’agriculture est le troisième poste dans la balance commerciale française derrière l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Premier constat, la diversité est ce qui fait sa singularité. Aucun pays au monde n’a une production alimentaire aussi riche que celle de la France. Ceci s’explique entre autres par la très forte diversité des sols et des climats[i]. S’y ajoutent les systèmes agricoles des territoires de l’outre-mer qui aussi ont leurs spécificités.
Mais jusqu’à une période récente, l’agriculture n’était plus considérée comme un enjeu stratégique. Les derniers commissaires européens en charge de ce dossier l’ont plus traité comme une contrainte marchande que comme un atout ou une nécessité. En France, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire affiche une dimension technique et sa direction administrative n’a pas cherché à revendiquer une posture plus importante dans la définition de la politique gouvernementale. Mais existe-t-il sur ce sujet une vision du politique ?
Depuis Edgard Pisani[ii], aucun chef d’Etat ou de gouvernement n’a voulu ou su aborder la question agricole en dehors du cadre des négociations « incontournables » sur la Politique Agricole Commune. Au fil des années, l’agriculture est devenue un angle mort alors qu’elle avait été au cours des siècles précédents le socle de notre économie intérieure. Aujourd’hui, l’agriculture française doit faire face à des menaces majeures. Citons-en quelques-unes : l’agressivité commerciale des nouveaux conquérants (pays sud-américains et Russie), la déstabilisation des modèles classiques de production (élevage) par des promoteurs d’une alimentation cellulaire (viande artificielle), le développement par des groupes multinationaux de monocultures qui déstabilisent l’équilibre précaire de l’agriculture des pays pauvres.
Il n’est pas possible de faire l’impasse sur le cas exemplaire de l’Ukraine. Depuis la fin des années 90, les représentants des Etats-Unis accordent à l’agriculture ukrainienne une attention soutenue. L’ambassade américaine à Kiev était celle qui abritait le plus grand nombre de conseillers agricoles parmi l’ensemble des représentations diplomatiques du Département d’Etat à travers le monde. Un quart de siècle plus tard, une proportion importante des terres ukrainiennes a été acquise par des groupes étrangers. Ces derniers développent une politique de conquête des marchés de l’Union Européenne comme le confirme la réaction très hostile des paysans polonais. La France comme ses partenaires européens est en situation de grand écart : comment soutenir l’Ukraine face à l’invasion russe sans détruire une partie de l’agriculture de certains des Etats Membres. C’est ce type de contradiction qui oblige aujourd’hui le pouvoir politique français à reconsidérer l’agriculture comme un problème à haut risque sur le plan électoral à l’aube des élections européennes.
La résurgence du problème de la dépendance
Après la guerre, les pays européens dépendaient fortement des importations alimentaires américaines. En France, en 1947 il y avait encore des émeutes de la faim. Les tickets alimentaires de rationnement n’ont été supprimés qu’en 1949. Dans un contexte de forte croissance démographique, les Européens se sont réunis pour augmenter les productions agricoles et réduire leurs dépendances aux importations agricoles américaines pour se nourrir. Cette posture s’est diluée au fil du temps sous l’effet du mythe de la mondialisation des échanges et de la prépondérance des lois du marché. En Europe, outre les questions de pouvoir d’achat, la nourriture est devenue accessible partout et instantanément. Les mécanismes de la société de consommation ont fait oublier la fragilité potentielle de notre système d’alimentation. Il a fallu la succession des crises récentes pour mettre en exergue la vulnérabilité de certaines chaînes de valeur alimentaires. A titre d’exemple, la guerre en Ukraine a créé des difficultés d’approvisionnement sur les huiles de colza et de tournesol ou encore sur les engrais.
Les tensions géopolitiques internationales peuvent accentuer ce risque de rupture temporaire d’approvisionnement si l’évolution des conflits vient à paralyser certains circuits d’échange. Rappelons-nous à ce propos qu’une des causes des printemps arabes fut l’augmentation du prix du pain à la suite d’une très mauvaise récolte de blé en Russie. Fort d’un tel constat, il n’est pas aberrant d’inscrire la limitation de la dépendance agricole comme élément de stabilité politique d’un pays[iii].
Des Etats confrontés aux enjeux de puissance adoptent désormais une posture beaucoup plus stratégique à l’égard de l’agriculture. La Russie a interdit toutes les importations alimentaires européennes afin de stimuler son agriculture. La Chine structure l’ensemble des chaînes de valeur alimentaires avec une stratégie d’accaparement des terres en interne et le recours à l’achat de surfaces agraires à l’étranger. L’Inde avec 1,4 milliard d’habitants est à peu près autonome sur le plan alimentaire.
La nouvelle légitimité de la souveraineté alimentaire
Il faut hélas une guerre pour comprendre l’évidence de la notion de souveraineté alimentaire. Au cours de la première guerre mondiale, l’Allemagne s’est affaiblie fortement à l’arrière de ses lignes à cause de la dégradation constante de l’alimentation d’une partie de sa population. Le second Reich ne disposait pas d’une agriculture à la hauteur de ses besoins élémentaires. Ce constat ne doit pas être pris comme une anecdote passéiste. Les partisans effrénés du libre-échange estiment que le marché est la réponse à tous les besoins. La crise du Cov19 a démontré que ce n’était pas le cas en France. L’affaire de l’absence de masques et de tests reste dans toutes les mémoires. La question de l’agriculture échappe-t-elle à ce risque de démonstration par l’absurde qui a frappé l’économie de la santé ? L’économie agricole mondiale occidentale fonctionne encore au rythme de la flexibilité de l’offre du marché. L’apparition d’une financiarisation de l’agriculture impulsée par les fonds anglo-saxons renforce cette tendance. Ce libéralisme redevient même sauvage dans bien des domaines. Les trafics de produits agricoles liés au biocarburant font perdre plusieurs centaines de millions d’euros par an à l’agriculture française. Ce chiffre peut sembler dérisoire à certains mais il s’ajoute à d’autres dont l’ampleur peut être encore plus inquiétante. Ces mêmes fonds anglo-saxons cherchent à acquérir de plus en plus de terres agricoles, pour créer de nouvelles sources de profit en jouant sur la spéculation autour des normes émises à propos des émissions carbones. Ces signaux qui ressemblent de plus en plus à des alertes appuient la nécessité d’une réflexion approfondie sur la question de la souveraineté alimentaire.
Il n’existe pas une définition unique de la souveraineté alimentaire. Rappelons celle donnée en 1996 par l’ONG Via Campesina à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation à Rome et fut définie comme « le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité culturelle et agricole. […] La souveraineté alimentaire est une condition préalable d’une véritable sécurité alimentaire ». Mais la plus élémentaire serait de rappeler la légitimité d’un pays à décider de se donner les moyens appropriés centrés sur ses propres capacités productives afin d’alimenter sa population dans un contexte de guerre économique[iv] ainsi que dans les situations de crise provoquées par des conflits d’ordre géopolitique ou des catastrophes climatiques. Mais cette politique qui relève du bon sens élémentaire n’existe pas pour l’instant.
Les contraintes systémiques qui affectent la recherche d’une autonomie stratégique
L’agriculture française est intégrée dans un marché commun, dont la Commission européenne est compétente pour en définir les règles relativement à l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aujourd’hui, la France ne définit pas ses grandes orientations agricoles, l’Union européenne s’en occupe. Elle peut néanmoins influencer les négociations à Bruxelles et se conformer à ce qui aura été décidé. De la même manière, dans le cadre de ce marché commun, la France n’a qu’une marge de manœuvre limitée pour défendre les intérêts vitaux de son agriculture. Les mécanismes de protection pour soutenir la diversité agricole et la compétitivité de la France sont quasiment inexistants. Les mesures de sauvegarde, qui sont des restrictions d’urgence appliquées aux importations à titre temporaire pour faire face à des circonstances spéciales, restent exceptionnelles et sont souvent insuffisantes pour redresser une filière.
Sa seconde particularité est son rapport au vivant. Contrairement à un système industriel, l’agriculture est très dépendante de la saisonnalité. Dans le vin, la classification des millésimes reflète cette part d’incertitude quant aux récoltes et à la qualité du produit d’une année à l’autre.
La forte hétérogénéité de l’agriculture française crée des contrastes très marqués entre les différentes filières et régions. La complexité du monde agricole en raison de ses nombreux paramètres (biologiques, physico-chimiques, climatiques, sociologiques, économiques, politiques, sanitaires…) implique l’élaboration réaliste d’une grille de lecture qui complète l’approche traditionnelle par métiers. Une telle démarche doit servir de champ d’expérimentation méthodologique pour inciter le pouvoir politique et les différentes parties prenantes à rechercher la cohérence nécessaire au développement de la France agricole dans l’Europe.
Quel est le bilan de la politique européenne pour la France ?
Historiquement, quand le marché commun comportait 6 pays, la France était exportatrice nette vis-à-vis des autres pays européens. Au-delà de la dimension européenne, la France était devenue une puissance agricole mondiale grâce à la PAC. L’agriculture française était diversifiée et permettait de nourrir toutes les classes économiques françaises. Mais avec l’intégration de l’Espagne et des pays d’Europe de l’Est, l’équilibre français a été modifié. L’Espagne a concurrencé la production française de fruits et légumes, la Pologne, la production de poulets et de pommes, l’Europe de l’Est, la production de céréales. De fait, un poulet sur deux, deux poires sur trois ou encore trois raisins de table sur quatre consommés en France sont importés.
Face à l’entrée de nouveaux acteurs, à la déstabilisation induite, au manque de compétitivité de certaines filières françaises et au manque de marge de manœuvre dans le cadre de la politique agricole, la France a fait le choix tactique d’orienter ses productions agricoles vers un système de compétitivité hors-prix. C’est-à-dire que la qualité du produit l’emporte sur le prix. Toutefois, la montée en gamme de l’agriculture n’a pas eu pour conséquence directe d’augmenter la valeur ajoutée produite par l’agriculture. Aujourd’hui, on se retrouve dans un système agricole où la France n’est plus capable de nourrir ses propres habitants avec une alimentation cœur de gamme. De fait, la France, qui est le premier pays agricole de l’UE, est désormais importatrice nette vis-à-vis de ses homologues européens. Ce problème est structurel dans l’agriculture française et se renforce avec la baisse du niveau de vie des classes moyennes. La politique commerciale européenne soulève aussi des questions quant à la mise en place de mesures miroirs. En effet, l’UE a signé des accords de libre échange qui autorisent l’importation de produits agricoles qui ne respectent pas les standards européens. Par exemple, l’Ukraine peut exporter sans contrôle et restriction des produits agricoles vers l’UE, alors qu’elle ne respecte qu’un tiers des réglementations alimentaires européennes. La chose est similaire pour les pays
[i] La France est le point de rencontre entre la mer, l’océan et les montagnes, les plaines et les plateaux, les vallées et les polders. Elle est méridionale et septentrionale. Elle est calcaire, argileuse, granitique et basaltique.
[ii] Ministre de l’Agriculture dans les cabinets Michel Debré en 1961 et 1962, et de Georges Pompidou de 1962 à 1966. Il est à l’origine de la loi d’orientation agricole qui a modernisé l’agriculture française.
[iii] L’Histoire politique de la France a été marquée par le risque jusqu’au XVIIIe siècle par le danger des aléas climatiques pouvant entraîner des mauvaises récoltes, donc des pénuries et parfois des famines. Cet enchaînement de problèmes pouvait mener à des jacqueries qui déstabilisaient le pouvoir. Ce fut le cas sous la Monarchie mais aussi au début de la Révolution française.
[iv] Christian Harbulot, La guerre économique au XXIe siècle, Paris, VA éditions, mars 2024.