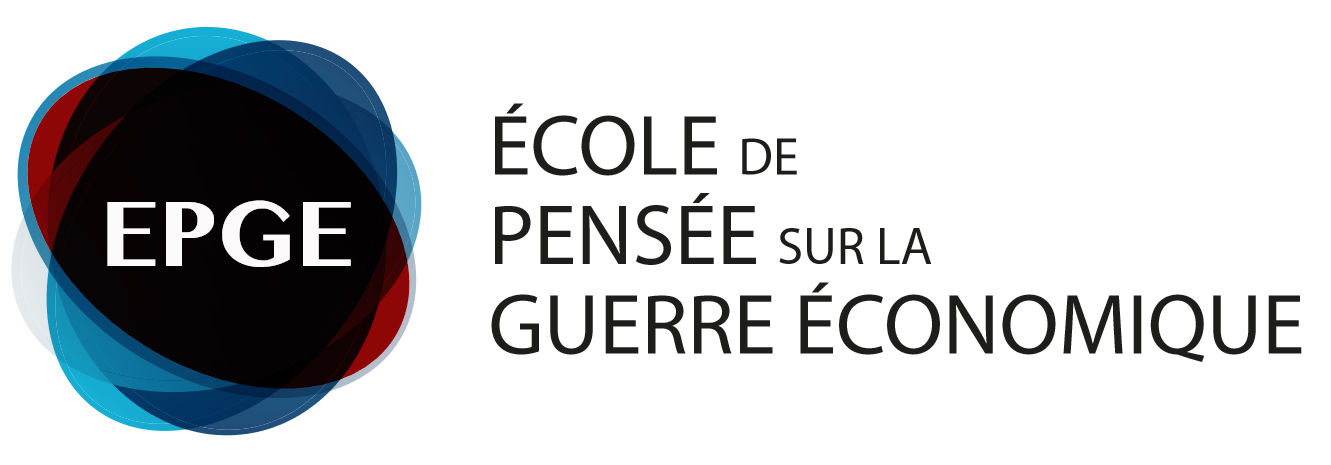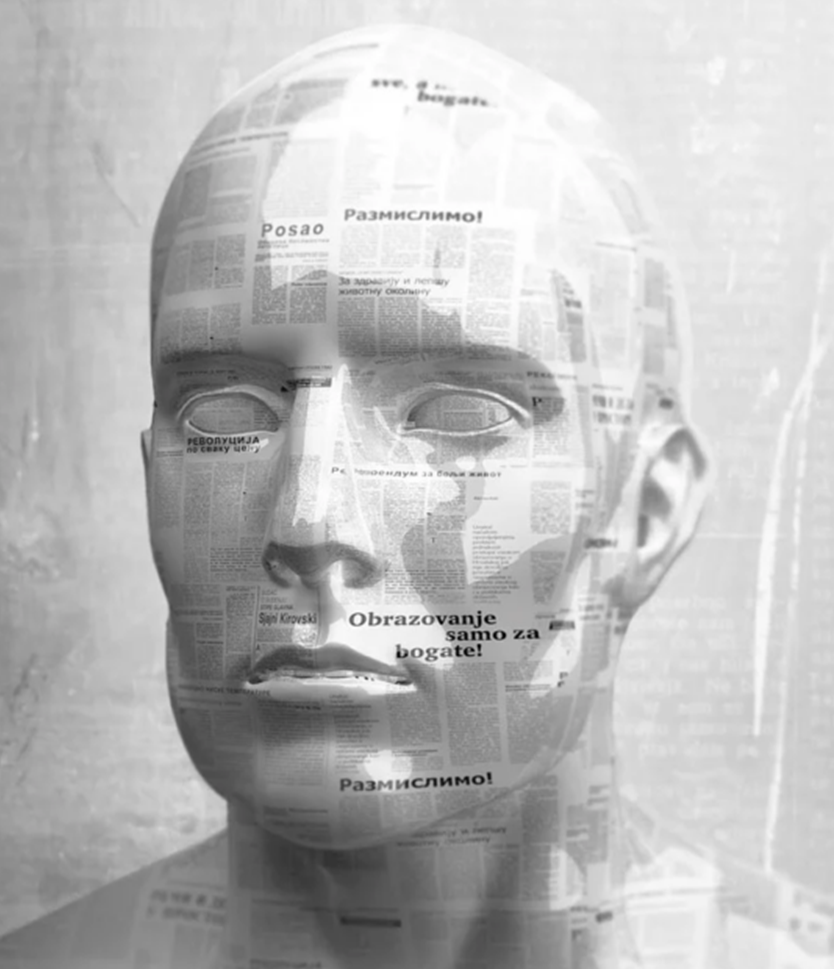
par Ali Moutaïb, Ismail Palamino, Global Governance and Sovereignty Foundation
La révolution médiatique amorcée en 2024 s’est confirmée, marquant l’avènement définitif d’un nouveau paradigme dans la guerre de l’information. Cette transformation profonde, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de décentralisation de la société, redéfinit radicalement les rapports de force informationnels à l’échelle mondiale. Ce virage décisif dont les récentes élections américaines ont été la preuve inéluctable ne profitera qu’à ceux qui ont su le prendre au bon moment. Les amateurs du travail de Nassim Nicholas Taleb reconnaîtront ici le concept du « Winner Takes All Effect » (Effet du gagnant qui rafle tout), où dans les systèmes massivement inégaux que sont le monde de la finance, de l’art, de la technologie et de la politique, un petit avantage peut conduire à une captation totale des gains.
Dans cette époque de l’influence où toutes les plateformes numériques se bousculent et sont en concurrence pour capter l’attention, l’ère n’est plus aux médias traditionnels, désormais, pour mener une campagne d’influence, qu’importe sa nature, le terrain de jeu a radicalement évolué.
L’effondrement accéléré du modèle vertical
Le déclin des médias traditionnels, déjà notable en 2024, s’est brutalement accéléré. Les géants historiques de la presse et de l’audiovisuel font face à une crise existentielle : effondrement des revenus publicitaires, perte massive d’audience, et surtout, disparition de leur autorité morale sur le débat public. Cette désaffection n’est pas un simple changement de mode de consommation – elle reflète l’obsolescence – d’un modèle vertical de l’information hérité du XXe siècle.
La croisade de Donald Trump contre le système médiatique traditionnel en 2016 avait un effet presque prémonitoire sur le constat actuel de l’état de ce que les Américains appellent « Legacy Media ». Partout dans le monde, la fracture entre le public et les médias traditionnels est plus que jamais grande, leur crédibilité est constamment remise en question. Alors que X et d’autres plateformes de réseaux sociaux continuent de dominer le paysage informationnel, les médias traditionnels se trouvent à un tournant critique. Les jeunes générations se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques pour s’informer et se divertir, laissant les médias traditionnels avec une base d’audience vieillissante et moins engagée.
La décentralisation comme nouvelle norme
Cette révolution médiatique s’inscrit dans un mouvement plus vaste de décentralisation qui touche tous les secteurs de la société. À l’image des cryptomonnaies qui ont bouleversé la finance traditionnelle, ou de l’uberisation qui a transformé l’économie, les nouveaux médias décentralisés redessinent le paysage informationnel. Mais s’il y a une réalité qui se dessine sous nos yeux, c’est que les médias traditionnels sont terriblement mal préparés à ce changement de paradigme de la diffusion et de la consommation de l’information. Alors que les « Legacy Media » peinent à maintenir leur crédibilité, les plateformes numériques sont devenues des machines puissantes dans la manufacture de l’opinion publique et des nouveaux leaders d’opinion.
Aujourd’hui, des créateurs indépendants sont préférés aux grandes institutions médiatiques dans la façon du public de s’informer. Les communautés autoorganisées définissent leurs propres narratifs, fini l’époque du pré-covid où toute opinion alternative était étouffée et entachée d’hérésie. Les plateformes numériques ont compris que l’enjeu de l’économie de l’attention se structure autour d’interactions directes entre les personnalités et leurs audiences, les hommes politiques qui ont su prendre ce virage l’ont exploité pour contourner les gardiens traditionnels des médias en communiquant directement avec leur base.
Les nouveaux champs de bataille de l’information
La guerre de l’information se joue désormais sur trois fronts principaux :
- Les plateformes décentralisées
X (anciennement Twitter) s’est imposé comme l’agora numérique mondiale par excellence. Sa transformation sous l’impulsion d’Elon Musk a catalysé l’émergence d’un espace informationnel plus ouvert, mais aussi plus conflictuel. Selon Musk, le modèle médiatique traditionnel, avec ses hiérarchies rigides et son contrôle éditorial, étoufferait un compte rendu complet et honnête des événements. Pour lui, le réseau X donne à chacun la possibilité de contribuer à la fabrication de l’actualité. Plutôt que de s’en remettre à une poignée d’éditeurs et de diffuseurs pour trier l’information, il estime que le public devrait pouvoir accéder directement aux sources, partager et analyser les événements par lui-même. Il voit dans cette démarche un transfert de pouvoir « transformateur », où les individus deviennent acteurs dans la construction et l’influence des récits, au lieu de rester passivement dépendants des médias traditionnels. D’autres plateformes comme Rumble, Kick ou Odysee ont émergé comme des alternatives crédibles aux géants traditionnels, fragmentant encore davantage les modes de diffusion et de partage des informations. Mais ces plateformes exacerbent la polarisation et certains leur reprochent d’être des Filter Bubbles (Bulles de filtres), qui est un concept popularisé par Eli Pariser. Ce concept renvoie à un espace informationnel personnalisé, créé par des algorithmes, qui filtre et sélectionne le contenu présenté à un utilisateur en fonction de ses comportements passés (clics, likes, partages, temps de lecture, etc.). L’objectif de ces algorithmes est d’améliorer l’expérience de l’utilisateur en fournissant du contenu « pertinent ». Cependant, cela a pour effet de limiter l’exposition à des perspectives divergentes, enfermant l’utilisateur dans une bulle où ses croyances et préférences sont constamment renforcées. Mais n’est-ce pas ici la conséquence de la longue hégémonie médiatique des médias traditionnels qui ne laissaient pas de place à des narratifs différents ?
- La même culture comme arme stratégique
Certains considèrent la victoire de Trump aux élections présidentielles américaines comme la victoire de 4Chan, ce forum américain, anonyme et non modéré, dont plusieurs éléments de la culture d’internet ont émergé. Quand un nouveau meme apparait, il vient souvent d’abord de 4chan, le forum est un vecteur des idées, des valeurs et des récits dans la culture numérique moderne. 4Chan a servi comme plateforme pour les plus grands supporters de Trump, pour défendre leur candidat et inonder internet de memes ciblés contre ses adversaires. Les mêmes sont devenus une arme informationnelle de premier plan. Au-delà de leur apparente légèreté, ils constituent un vecteur puissant de diffusion idéologique et de mobilisation communautaire. Les récentes crises géopolitiques ont vu l’émergence d’une véritable « guerre memétique » où les communautés s’affrontent à coups de contenus viraux pour imposer leurs narratifs. Mais 4Chan n’est pas que cela, le forum est également l’alliance de deux sphères devenues complémentaires, le monde des memes et celui des cryptomonnaies, d’où l’émergence des“memecoins”, ces cryptomonnaies basées sur l’image de célébrités. Les memecoins ne sont pas un nouveau phénomène dans l’univers des cryptomonnaies. Des centaines de memecoins inspirés d’Elon Musk existent depuis des années. Cependant, quelque chose d’inédit a eu lieu avec le président américain, un memecoin soutenu par la personne elle-même. Le 47e président des États-Unis a annoncé sa propre cryptomonnaie avant son inauguration, suivie par une autre lancée par son épouse, Melania. Toutefois, mis à part enrichir la personne à l’origine de leur création, les memecoins ne sont pas d’une véritable utilité pour leur détenteur, ils finissent quasiment tous par perdre leur valeur une fois le boucan estampé. Mais pour un personnage comme Trump, l’enjeu va au- delà de l’enrichissement personnel, son memecoin cultive des liens communautaires forts parmi ses détenteurs, et sert de preuve de loyauté pour ses soutiens.
- Les podcasts et le streaming longue durée
Le format podcast s’est définitivement imposé comme le nouveau standard du débat public approfondi. Les entretiens fleuves sur Twitch ou Kick, pouvant durer plusieurs heures, permettent des discussions de fond impossibles dans les formats traditionnels. L’élection américaine de 2024 a été un moment décisif pour les podcasts, confirmant leur montée en puissance. Ce format a dépassé les médias classiques, que ce soit en audience ou en capacité à mobiliser les votants, particulièrement l’électorat jeune. Quand Donald Trump a été l’invité du « Joe Rogan Expérience » ,l ’épisode a été téléchargé plus de 100 millions de fois sur toutes les plateformes. C’est plus du double du nombre de personnes qui ont suivi le premier débat Trump-Biden sur la chaine CNN. Pourtant, derrière le podcast JRE, il n’y a que Joe Rogan et son assistant Jamie, et ils y consacrent que quelques heures par semaine. À l’inverse, des rédactions entières de plusieurs dizaines de personnes travaillent jour et nuit pour produire les émissions télévisées de CNN. Les podcasts réussissent à se connecter avec toutes les tranches d’âges, en particulier les jeunes, d’une façon que les médias traditionnels ne comprennent même pas, et encore moins réussissent à reproduire. Le public se tourne vers les podcasts parce qu’ils sont souvent perçus comme indépendants, authentiques, proches de leur réalité et plus crédibles que les grands médias. Ce n’est pas un hasard que le podcast le plus écouté aux États-Unis soit le Shawn Ryan Show – un podcast présenté par un ancien soldat de l’U.S Navy Seals – où il donne la parole à des personnages que l’on n’entend pas habituellement dans les médias.
L’émergence d’une nouvelle guerre cognitive
Cette décentralisation de l’information transforme radicalement la nature de la guerre cognitive. Les opérations d’influence traditionnelles, pensées pour un monde médiatique vertical, deviennent obsolètes face à des dynamiques communautaires complexes et auto-organisées. Dans les années à venir, il est clair que le paysage médiatique continuera d’être façonné par les avancées technologiques, les changements de comportement des consommateurs et l’influence croissante des plateformes de réseaux sociaux. Les médias traditionnels qui ne parviennent pas à anticiper et à répondre à ces changements risquent de tomber dans l’obsolescence dans un monde de plus en plus numérique.
Un défi majeur pour les États
Les récits jouent un rôle déterminant dans la manière dont les individus perçoivent et donne du sens à la réalité. Le contrôle du narratif influence de manière significative l’opinion publique, les dynamiques de pouvoir et les valeurs de la société. Dans le domaine des médias, le contrôle du narratif peut dicter la manière dont les événements sont représentés. Le choix des titres, des images et des reportages peut façonner le narratif autour d’un personnage ou d’un événement, comme l’a expliqué Noam Chomsky à travers son concept de « Manufacturing Consent » (Fabrication du consentement). Mais l’essor des réseaux sociaux a démocratisé la narration, et permis à une plus grande diversité de voix de s’exprimer.
Le pouvoir d’aujourd’hui est enveloppé dans un jargon du monde de la tech, imprégné de la culture d’internet. Des patrons comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk exercent un contrôle sur l’information qui dépasse celui des dirigeants historiques, pourtant le narratif autour de ces figures nous oblige à les percevoir comme des génies innovateurs, parangons de la liberté d’expression. L’émergence de ce nouveau pouvoir au sein de la guerre de l’information équivaut à un appel à la souveraineté cognitive dans une ère où notre réalité est manufacturée. Cette transformation pose un défi existentiel aux États et aux institutions traditionnelles. La capacité à contrôler l’information, historiquement une prérogative régalienne, s’érode face à des réseaux décentralisés impossibles à contrôler de manière centralisée. Les services de renseignement et les organes diplomatiques doivent repenser entièrement leurs modes d’action dans cet environnement nouveau.
La période 2024-2026 marque ainsi l’émergence d’un nouvel ordre informationnel mondial, caractérisé par la décentralisation et la désintermédiation. Cette transformation dépasse largement le cadre médiatique : elle reflète un changement profond dans l’organisation du pouvoir à l’échelle mondiale.
Dans ce nouveau paradigme, la puissance ne réside plus dans le contrôle centralisé de l’information, mais dans la capacité à mobiliser et à influencer des communautés décentralisées. Les acteurs qui sauront maîtriser ces nouvelles dynamiques – qu’ils soient étatiques, privés ou communautaires – seront ceux qui domineront la guerre de l’information du XXIe siècle.