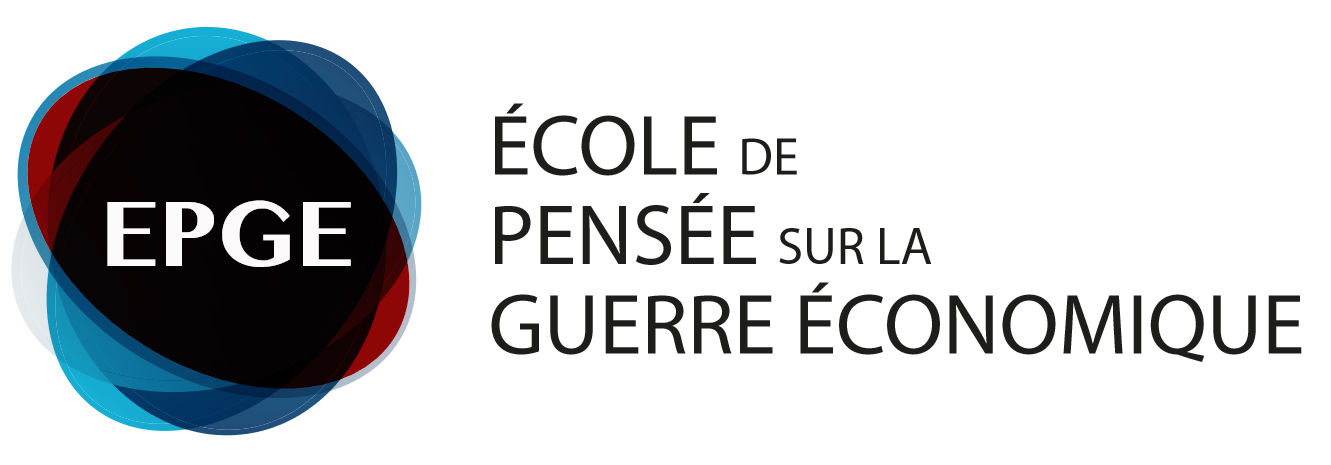Le retour de Guiseppe Gagliano du CESTUDEC (Milan/Italie) sur la séance d’audition du 27 mars 2025, devant la Commission d’enquête sur la réindustrialisation de la France. (témoignages de Bernard Carayon, Alain Juillet, Christian Harbulot, et Frédéric Pierucci).
Au cœur de Paris, le 27 mars 2025, s’est tenue l’une des auditions parlementaires les plus importantes et en même temps les plus désolantes des dernières années : la Commission d’enquête sur les freins à la réindustrialisation de la France. Dans une salle presque vide, avec seulement quatre députés présents, s’est déroulé un échange de très haut niveau entre les rares experts encore engagés dans la défense du concept de souveraineté industrielle nationale.
Le président Charles Rodwell et le rapporteur Alexandre Loubet ont accueilli en visioconférence quatre témoins d’exception : Bernard Carayon, maire de Lavaur et ancien député ; Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE ; Christian Harbulot, directeur de l’Ecole de Guerre Économique ; et Frédéric Pierucci, ancien cadre dirigeant d’Alstom et victime directe de l’agressivité juridique extraterritoriale américaine. Un panel qui, par ses compétences et expériences, pourrait constituer un Conseil de sécurité économique.
Le diagnostic de Bernard Carayon : le retour du colbertisme et la fracture de l’État
Carayon a ouvert les travaux avec une déclaration programmatique claire : « L’industrie est le moteur de la recherche, de l’enracinement territorial, de la promotion sociale et de la souveraineté technologique ». Sans industrie, la France ne peut pas être une puissance. Il a dénoncé le blocage idéologique qui, pendant des années, a rendu tabous les termes de « patriotisme économique » ou de « politique industrielle ». Ces concepts redeviennent d’actualité, mais dans un contexte dramatiquement dégradé.
Entre 2015 et 2018, la fracture de l’État s’est illustrée avec la question de la taxonomie européenne. Conception idéologique née au ministère de la Transition écologique, reprise par la direction du Trésor, elle a exclu la filière nucléaire des énergies durables, l’empêchant d’accéder à des financements publics. Une décision suicidaire, applaudie par Bruxelles.
Carayon a appelé à l’unité de l’État, à la stabilité fiscale, à la simplification administrative, et surtout au courage diplomatique. Il a critiqué l’obsession européenne pour les « aides transversales » incapables de soutenir des secteurs stratégiques. Il propose un nouveau Fonds stratégique d’investissement national, financé par capital public et épargne privée, capable de mobiliser 200 à 300 milliards.
Enfin, il a souligné que le filtrage des investissements étrangers dépend d’un simple chef de bureau à Bercy. Et a rappelé l’absence de réciprocité commerciale : « La Chine ne respecte pas les conventions de l’OIT sur les droits syndicaux. Pourtant, nous continuons à importer librement ».
Alain Juillet : l’intelligence économique est la guerre du XXIe siècle
L’ancien directeur du renseignement extérieur a donné le ton stratégique : « Nous n’avons pas d’amis. Nous sommes en guerre économique mondiale. Celui qui gagne est celui qui est le mieux informé. » Il a comparé la situation à la guerre en Ukraine : sans les renseignements américains, l’Ukraine ne pourrait pas résister.
En économie, c’est la même chose : les services français ne sont pas préparés, manquent d’expertise sectorielle (santé, défense, alimentation), et luttent avec une culture orientée uniquement vers l’antiterrorisme. Le problème, dit-il, n’est pas l’argent, mais les priorités politiques.
Il a dénoncé l’abandon de l’Afrique par les banques françaises au profit des banques marocaines, et l’exode des start-up françaises vers les États-Unis et la Chine, qui récupèrent nos chercheurs, ingénieurs et entreprises naissantes. « Les autres agissent comme des blocs public-privé. Nous, nous sommes désorganisés ».
Christian Harbulot : la guerre économique en temps de paix, la doctrine perdue
Avec un ton à la fois polémique et analytique, Harbulot a pointé le « point aveugle » français : l’incapacité à penser l’accroissement de puissance par l’économie. Il a rappelé les réussites de la France pendant la Première Guerre mondiale en matière de guerre économique, et les cas de la Corée du Sud ou du Japon, qui ont utilisé la stratégie économique pour survivre à des crises existentielles.
Il a dénoncé l’interdiction faite par le Commissariat au Plan dans les années 90 d’aborder la notion d’affrontement entre puissances. Il a accusé Ambroise Roux (CGE) d’avoir saboté la politique industrielle de De Gaulle dans le domaine de l’informatique.
« Il nous faut une culture officielle de la guerre économique », a-t-il insisté. Il a appelé à une mobilisation civile, à des contre-attaques informationnelles, à la formation stratégique. Et lancé : « Si nous ne sommes même pas capables de manifester devant les ambassades étrangères lorsqu’on pirate nos hôpitaux, autant aller vendre des gaufres à la plage ».
Frédéric Pierucci : le colonialisme juridique américain expliqué par une victime
Frédéric Pierucci, ex-dirigeant d’Alstom arrêté en 2013 par le DOJ américain, a dénoncé l’extraterritorialité du droit américain comme instrument de domination économique. Depuis la fin de la Guerre froide, affirme-t-il, les services américains ont réorienté leur action vers l’espionnage économique. Il estime que 60 % de leurs activités concernent l’économie.
Il a énuméré l’arsenal juridique américain : FCPA, OFAC, ITAR, Cloud Act, Patriot Act… utilisés pour sanctionner et faire pression. Puis, les entreprises sont invitées à venir s’installer aux États-Unis : énergie bon marché, subventions (IRA), protection juridique exclusive.
Il a cité l’exemple de Siemens, sauvée par un prêt de 15 milliards de l’État allemand, sans demander l’accord de Bruxelles. Et déploré que la France continue de jouer avec des « règles » que personne d’autre ne respecte.
Les réponses aux députés : le naufrage organisé de la souveraineté
Face aux questions du président Rodwell, les intervenants ont confirmé la faiblesse des moyens. Carayon a rappelé que les services de filtrage des IDE sont dirigés par un chef de bureau. Juillet a pointé l’absence de contrôle du respect des engagements des investisseurs. Harbulot a dénoncé le retour du corporatisme dans la DGSI. Pierucci a révélé que dans les cas Alstom ou Alcatel, l’État savait, mais n’a pas agi.
Sur le financement, Carayon a plaidé pour un fonds souverain de 300 milliards, Juillet pour le retour à l’emprunt populaire (comme les emprunts Pinay), Pierucci pour une commande publique orientée vers les entreprises françaises. « Les États-Unis ont bâti leurs champions sur la commande publique, nous finançons Amazon et Microsoft avec notre argent public. »
LMB Aerospace, Photonis : deux poids, deux mesures
Le député Loubet a évoqué le cas de LMB Aerospace, équipementier stratégique pour les Rafale, chars Leclerc et SNLE. En risque de rachat par des fonds américains, l’entreprise reste ignorée des médias. Contrairement à Photonis, sauvée grâce à l’attention médiatique.
Carayon a appelé à une mobilisation transpartisane. Juillet a recommandé la pression médiatique. Harbulot a proposé le soutien des étudiants de l’EGE pour une campagne d’influence. Pierucci a conclu : « Quel parti politique pourrait s’opposer à la défense d’une entreprise française stratégique ? Aucun ».
Atlantisme et omerta : la longue marche de la colonisation culturelle
À la question du député Tanguy sur l’« atlantisme », Carayon a rappelé la fascination aveugle des élites françaises pour les États-Unis, même lorsqu’ils les spolient. Harbulot a évoqué la visite d’une agente de la CIA à l’EGE dès 1997. Juillet a raconté les campagnes de diffamation qu’il a subies. Pierucci a mis en cause les trajectoires de carrière fulgurantes de ceux qui ont facilité la vente d’Alstom.
ONG, cabinets de conseil, presse : les armes d’une guerre invisible
Les intervenants ont démonté le mythe de la neutralité des ONG. Selon Juillet, Carayon et Harbulot, elles sont souvent financées par des États ou des multinationales, et attaquent l’industrie française. Certaines reçoivent même des fonds publics. Harbulot parle de « rente de situation » : les ONG sont devenues des carrières lucratives, déconnectées de tout idéal.
Pierucci a révélé que l’OCCRP (consortium de journalistes à l’origine des Panama Papers) était financé par USAID et opérait sous influence du Département d’État. Aucun scandale financier américain n’y figure.
Concernant la presse, Juillet parle de contrôle idéologique et économique. Harbulot appelle à des campagnes de contre-influence légitimes.
Conclusion
Au terme de cette audition, une question demeure : comment un État peut-il survivre s’il finance les ONG qui sabotent ses politiques publiques, s’il marginalise ses propres experts, s’il délègue sa souveraineté numérique, et s’il criminalise la notion même d’intérêt national ? Si la réponse n’est pas trouvée rapidement, d’autres réécriront à notre place l’histoire industrielle de la France. Ce processus est déjà bien engagé.