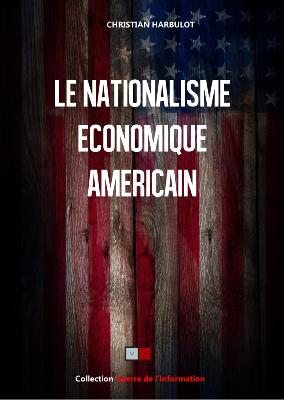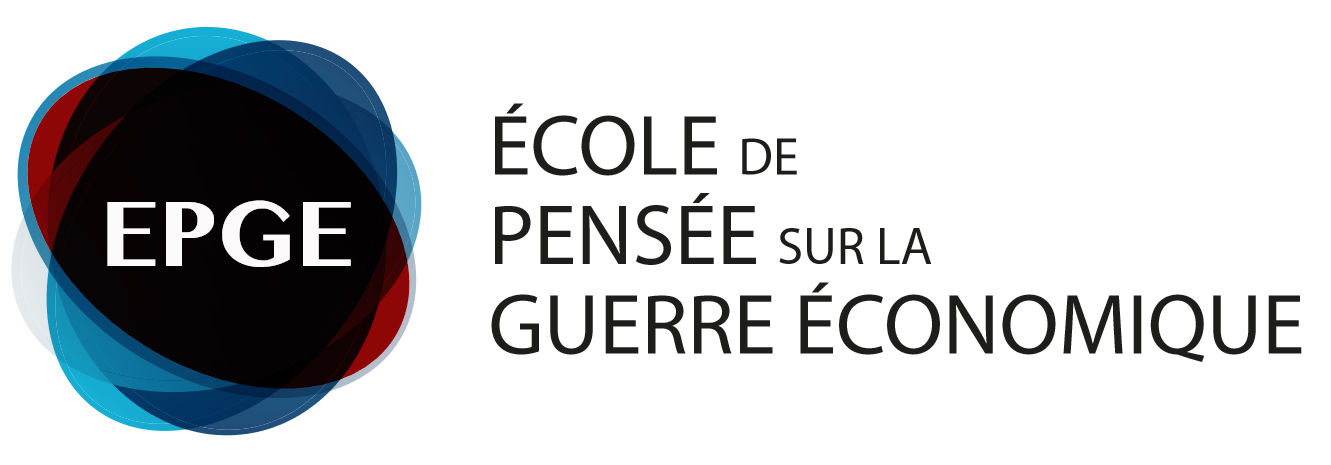Par Guiseppe Gagliano (cestudec centro studi strategici carlo de cristoforis)
Au début du XXe siècle, les États-Unis étaient déjà un géant industriel, avec une croissance économique soutenue par l’expansion des infrastructures et l’augmentation de la production manufacturière. Cependant, le pays devait trouver un équilibre entre l’ouverture aux marchés internationaux et la protection de son industrie nationale.
De l’essor industriel au retour du protectionnisme
En 1912, le débat politique et économique était dominé par quatre visions différentes. Le conservatisme de William H. Taft mettait en avant le rôle du dollar comme outil de diplomatie économique, renforçant ainsi la position financière des États-Unis dans le commerce mondial. L’alternative socialiste d’Eugene Debs visait à redistribuer la richesse et à réduire les inégalités sociales. Le “Nouveau Nationalisme” prônait une plus grande régulation de l’économie par l’État pour lutter contre les monopoles, tandis que la “Nouvelle Liberté” cherchait à limiter l’influence des grandes entreprises par de nouvelles lois antitrust.
L’adoption de l’Underwood-Simmons Act en 1913, qui réduisit significativement les tarifs douaniers, semblait indiquer un virage vers le libre-échange. Cependant, l’équilibre entre protectionnisme et libéralisme économique se révéla fragile : avec l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, le gouvernement adopta des mesures protectionnistes pour garantir l’autosuffisance industrielle et soutenir l’économie nationale face aux perturbations du commerce mondial.
Entre exportations en hausse et stratégies géoéconomiques
Dans la décennie précédant la guerre, le commerce américain connut une expansion sans précédent. Les exportations augmentèrent de 1,6 milliard à 2,5 milliards de dollars, tandis que les importations passèrent de 920 millions à 1,99 milliard. Cette période vit également une forte hausse des investissements américains à l’étranger, qui passèrent de 673 millions de dollars en 1897 à plus de 348 milliards en 1914.
L’élection de Woodrow Wilson en 1913 entraîna une première tentative d’ouverture économique, avec une réduction tarifaire moyenne de 30 %. Cette politique permit un afflux accru de produits étrangers sur le marché américain, mais rendit également les États-Unis plus vulnérables aux fluctuations de l’économie mondiale. La guerre, cependant, changea radicalement cette tendance, poussant le gouvernement à réintroduire des barrières commerciales pour protéger l’industrie nationale de la concurrence étrangère.
L’interventionnisme de Roosevelt et la redéfinition des stratégies commerciales
Dans les années 1930, la crise économique mondiale incita le gouvernement américain à revoir sa politique économique. En 1932, Franklin Delano Roosevelt présenta un plan visant à gérer plus rationnellement les ressources industrielles, à promouvoir la consommation intérieure et à rééquilibrer la distribution des richesses.
L’un des piliers de sa stratégie fut la dévaluation du dollar, destinée à rendre les exportations américaines plus compétitives. Le Reciprocal Trade Agreement Act de 1934 introduisit une nouvelle approche des accords commerciaux, basée sur la réciprocité tarifaire. Cela permit aux États-Unis de négocier des réductions douanières allant jusqu’à 50 % en échange de concessions équivalentes de la part des pays partenaires.
En 1936, Washington signa des accords commerciaux avec la France et renforça ses liens économiques avec le Canada et l’Amérique latine, créant ainsi une sorte de “zone du dollar”. Cependant, les politiques de Roosevelt ne furent pas exemptes de critiques : certains analystes, comme Henry Luce, accusèrent le président de manquer de vision économique globale, soulignant l’importance d’un ordre économique international mieux structuré.
La Seconde Guerre mondiale et le triomphe économique américain
Entre 1941 et 1945, le gouvernement fédéral dépensa plus du double de ce qu’il avait investi au cours des 150 années précédentes. Cette intervention massive de l’État fut le moteur de la reprise économique américaine, transformant le pays en ce que l’on appela “l’arsenal des démocraties”.
L’industrie de guerre américaine produisit une quantité énorme d’armements, de véhicules et de matériaux stratégiques, alimentant une croissance sans précédent. À la fin du conflit, les États-Unis émergèrent comme la principale puissance économique mondiale, avec un excédent commercial imposant et un système industriel hautement avancé.
Le protectionnisme resta un élément clé de la politique économique américaine, mais le contexte international exigeait une nouvelle approche. L’Europe, dévastée par la guerre et lourdement endettée envers les États-Unis, ne pouvait être laissée à la dérive, surtout face à la menace soviétique croissante.
Le double jeu de l’après-guerre : banquier mondial et gardien du commerce
Après la guerre, les États-Unis se retrouvèrent en position de domination économique mondiale. D’un côté, ils promouvaient le libre-échange à travers le Trade Act de 1945, visant à éliminer les barrières commerciales et les pratiques anticoncurrentielles. De l’autre, ils renforçaient leur rôle de “banquiers du monde”, exerçant une influence décisive sur les économies européennes.
Le Plan Marshall fut l’exemple le plus évident de cette stratégie : les fonds de reconstruction accordés aux pays européens étaient conditionnés à l’adoption de politiques de libre-échange, facilitant ainsi l’accès des entreprises américaines aux marchés étrangers. La création du GATT en 1947 établit en outre un cadre réglementaire favorable aux intérêts américains, posant les bases d’un système commercial mondial modelé sur les règles des États-Unis.
Protectionnisme et mondialisation : l’équilibre instable de la superpuissance
Pendant la Guerre froide, les États-Unis maintinrent une politique commerciale sélective, favorisant le libre-échange dans les zones d’intérêt stratégique tout en maintenant des barrières protectionnistes dans les secteurs sensibles. Cependant, à partir des années 1970, la montée en puissance de nouveaux acteurs économiques, comme le Japon et la Chine, poussa Washington à reconsidérer ses politiques commerciales.
Dans les années 1980, le Buy American Act fut renforcé pour mieux protéger les industries nationales, tandis que les États-Unis négocièrent des accords bilatéraux avec des partenaires sélectionnés, préférant une approche individualisée plutôt qu’un engagement multilatéral généralisé.
Le XXIe siècle : nouveaux défis et retour au protectionnisme
Avec l’entrée dans le XXIe siècle, la mondialisation transforma profondément l’économie américaine. L’essor de la Chine en tant que puissance industrielle et l’expansion du commerce mondial placèrent les États-Unis face à une concurrence économique sans précédent.
Entre 2008 et 2016, l’administration américaine adopta des mesures de plus en plus protectionnistes, imposant des barrières aux accords de libre-échange et introduisant des tarifs ciblés sur les importations chinoises et européennes. L’élection de Donald Trump en 2016 accéléra cette tendance, avec une augmentation drastique des droits de douane et une renégociation des accords commerciaux internationaux.
Ce retour au protectionnisme marqua un changement radical par rapport aux politiques des décennies précédentes, démontrant que le nationalisme économique américain n’a jamais totalement disparu, mais qu’il réapparaît lors des crises comme un outil fondamental de défense des intérêts nationaux.
pour aller plus loin :
Le nationalisme économique était considéré jusqu’à présent comme une pensée archaïque en voie de disparition. Donald Trump a relancé le débat en dénonçant les excès commis par des pays concurrents comme la Chine, le Japon ou l’Allemagne. Le Président des Etats-Unis prône un recours au protectionnisme pour maintenir de l’emploi sur le territoire américain. La remise en cause des traités commerciaux ouvre une nouvelle ère de la mondialisation des échanges.
La guerre économique n’est plus à exclure dans les confrontations économiques du XXIe siècle. Afin de mieux cerner ce renversement de situation, l’Ecole de Guerre Economique a retracé le cheminement de la pratique du nationalisme économique dans l’Histoire de la nation américaine. Il apparaît clairement que le libéralisme est d’abord un discours et non une ligne de conduite permanente qui différencie les partisans du libre-échange des souverainistes de tout bord.
Les pouvoirs exécutifs qui se sont succédé à la Maison Blanche ont eu comme priorité absolue de bâtir une économie en adéquation avec leur recherche de puissance sur la scène internationale.