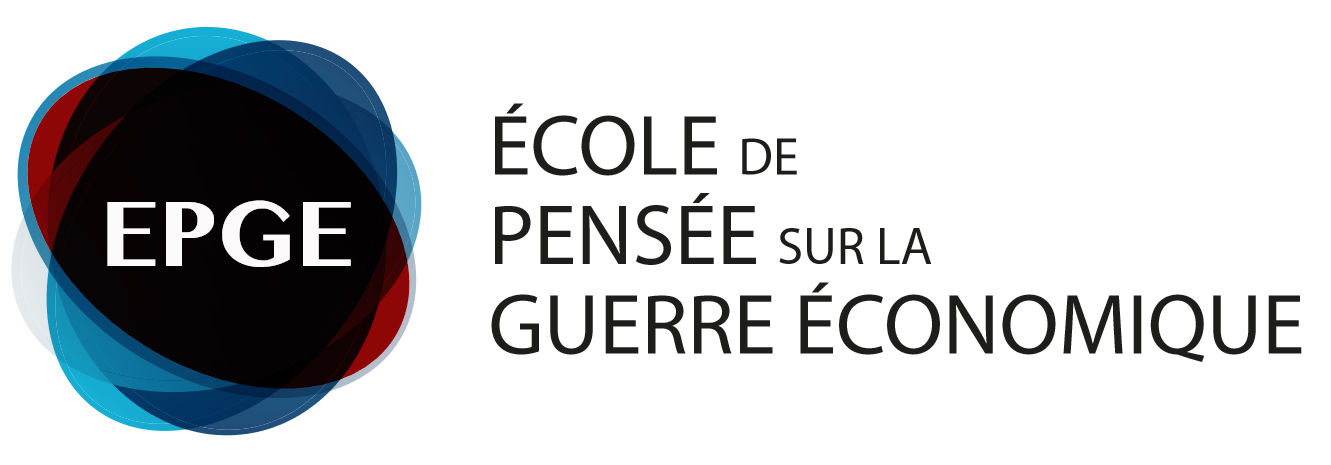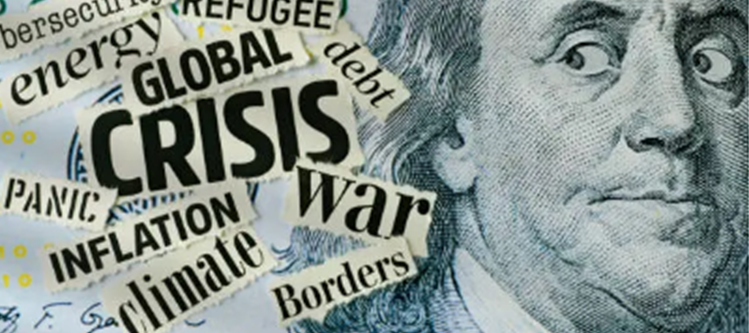
Christian Harbulot pour la rédaction de l’EPGE
Au début des années 2000, les premières interrogations ont commencé à s’exprimer sur le devenir de la « mondialisation heureuse ». Les problématiques de puissance n’étaient pas encore aussi affirmées qu’aujourd’hui mais la disparition de l’ennemi principal à la suite de la fin de la guerre froide n’avait pas gommé les rapports de force économiques qui resurgissaient peu à peu. Les deux articles qui suivent montrent à quel point la problématique de la guerre économique était encore un repoussoir. On comprend mieux en les lisant le chemin qui reste à parcourir pour intégrer le concept aux grilles de lecture nécessaires pour décrypter les évolutions tumultueuses du monde actuel.
La guerre économique n’aura pas lieu
Les ECHOS-15 avr. 2003
Après l’angélisme de la mondialisation heureuse, voici les temps apocalyptiques de la guerre économique planétaire. On attend désormais avec inquiétude la guerre économique que les Américains pourraient déclarer à l’Europe. Il faut dire qu’à force d’user à tort et à travers du langage guerrier, on a fini par accréditer l’idée selon laquelle la compétition économique serait par nature une forme de guerre permanente. A trop vouloir occuper des créneaux, prendre des positions, conquérir des parts de marché, capturer des clients, monter des raids, on finit par perdre de vue les finalités de l’économie. A force de confondre à tout bout de champ la compétition économique avec la guerre, on substitue progressivement la logique du prédateur à celle de l’entrepreneur.
Mais la croissance externe tous azimuts, les OPA hostiles, les OPE, la guerre des prix, l’espionnage industriel, la manipulation des cours, la propagande, traduisent davantage une volonté de puissance qu’ils ne sont créateurs de valeur ajoutée, de rentabilité et d’emplois. La logique de la prédation a pour corollaire le jeu économique à somme nulle, voire négative, c’est-à-dire l’exact contraire de l’économie de croissance. Le raider peut s’enrichir mais il ne crée rien, et la mégalomanie du chef d’entreprise qui achète tout ce qui passe à portée de sa main parce qu’il rêve de devenir maître du monde est destructrice.
La concurrence n’est pas la guerre, elle n’a pas pour objectif de détruire l’ennemi et de s’emparer de son territoire. Le but de la concurrence est de pousser chacun à tirer le meilleur parti de lui-même pour séduire le client et le fidéliser en répondant le mieux possible à ses besoins. Le client n’étant pas à vendre ni à capturer, l’entreprise n’a pas d’autre solution pour créer de la valeur que l’innovation, la qualité, la fiabilité et le professionnalisme. Et pour un pays, la croissance économique est affaire de travail, d’épargne, d’investissement, de productivité et de créativité.
La pure logique de l’économie de marché est celle de la division du travail, de la spécialisation, de la différenciation et de l’échange, à l’opposé de la logique de la guerre de tous contre tous. Certes, la violence est trop enracinée dans l’homme et trop liée à la rareté pour que la compétition économique en soit exonérée, mais la violence en économie obéit davantage à la psychologie des profondeurs qu’à la rationalité économique, et elle a plus à voir avec la quête du pouvoir qu’avec celle de la productivité.
Si guerre économique il y a parfois, c’est parce que la guerre est susceptible d’envahir aussi le champ de l’économie, non parce que la logique économique est en soi une logique de guerre. Et si l’Amérique déclarait la guerre économique à l’Europe et en particulier à la France, ce serait parce qu’elle ferait prévaloir la logique politique sur la logique économique et non l’inverse, ou, pour être plus exact, qu’elle sacrifierait la logique économique à la logique politique, comme Napoléon au temps du blocus continental.
Mais puisque l’économie de guerre est exactement le contraire de l’économie d’échange et de la libre concurrence, on perçoit aisément à quel point une véritable déclaration de guerre économique marquerait une rupture radicale avec le modèle de l’économie de marché que l’Amérique cherche, non sans quelque hypocrisie, à promouvoir dans le monde depuis plus d’un demi-siècle. La guerre économique, c’est-à-dire en l’occurrence la subordination proclamée de tous les moyens de l’Amérique à sa politique de puissance, signerait immanquablement la fin de l’idéologie du libre-échange comme moteur d’une mondialisation qui devait marquer la fin de l’Histoire par l’avènement universel de la démocratie de marché.
Là serait sans nul doute la vraie victoire des terroristes du 11 septembre : le rêve américain brisé par la volonté de puissance de l’Amérique. Dès l’automne 2001 on pouvait pressentir que la lutte contre le terrorisme allait provoquer une reprise en main de l’économie par le politique qui commencerait par la surveillance des circuits financiers. Une étape de plus vient d’être franchie avec l’installation de la puissance militaire américaine dans le coeur pétrolier du Moyen-Orient. Avec une déclaration de guerre économique à l’Europe, la boucle serait en quelque sorte bouclée : en renonçant ouvertement à la loi du marché, l’Amérique proclamerait qu’à ses yeux les affaires du monde seraient trop sérieuses pour être confiées au libre jeu de l’offre et de la demande comme à celui de la démocratie. Elle signifierait par là même qu’elle ferait sienne désormais la vieille doctrine de la souveraineté limitée. Bref, l’Amérique adopterait ouvertement une logique non pas impérialiste, comme aurait dit Lénine, mais impériale.
Avec le déficit chronique de sa balance courante, cela fait bien longtemps que l’Amérique vit à crédit en aspirant l’épargne du reste du monde. Avec le dollar, cela fait bien longtemps qu’elle utilise l’arme monétaire au service de ses entreprises. Avec ses innombrables réseaux d’influence, les moyens qu’elle consacre à l’intelligence économique, son unilatéralisme en matière commerciale, son poids dans les organisations économiques internationales, cela fait bien longtemps que l’Amérique ne se soumet pas loyalement aux règles de la libre concurrence qu’elle prétend imposer aux autres. Bref, cela fait bien longtemps que l’Amérique met tous ses moyens au service de son économie. En ce sens, la guerre économique est déjà engagée. Mais cette guerre-là n’a rien à voir avec celle dont on évoque aujourd’hui l’éventualité et dont l’objectif serait non pas la croissance mais la puissance hégémonique, non pas des débouchés pour ses produits mais la domination pure et simple.
On connaît le sort des empires : les empires sont des prédateurs qui finissent par mourir étouffés sous le poids de leurs charges. L’Amérique le sait, comme elle sait qu’elle n’a rien à gagner à donner le signal du retour général au protectionnisme. On peut raisonnablement penser qu’elle mène depuis Bretton Woods un jeu économique subtil qui lui a trop rapporté jusqu’à présent pour qu’elle choisisse délibérément d’y renoncer. Sauf à ce que l’ivresse de la toute-puissance emporte tout, il est probable donc que la guerre économique dont on parle tant n’aura pas lieu, et à trop chercher par avance dans cet hypothétique conflit des excuses à nos malheurs futurs, on perd de vue que la cause de ceux-ci est d’abord dans nos propres défaillances.
Sur le front de l’économie, l’heure n’est pas à la mobilisation guerrière mais au choix d’une stratégie monétaire, budgétaire et fiscale adaptée aux circonstances et à l’investissement massif dans les infrastructures, la recherche et l’éducation pour créer les conditions du développement durable.
La guerre économique, un concept en débat
28 mai 2014, par Pierre-André Bizien
De l’économie de guerre à la guerre économique
Si la guerre et l’économie ont souvent été liées par des liens étroits, tant dans le déclenchement que le déroulement des conflits armés, le XXe siècle s’est pourtant distingué des époques antérieures par l’essor des « économies de guerre » modernes. Apparues lors de la Grande Guerre, ces pratiques exceptionnelles étaient mises en œuvre par les États afin de mobiliser l’ensemble de leurs moyens de production au service de la destruction des armées adverses. Ainsi, les conflits mondiaux et la Guerre froide ont donné naissance à de puissants complexes militaro-industriels qui rivalisaient sans cesse dans l’amélioration quantitative et qualitative des armements.
Pourtant, la rivalité entre les blocs capitalistes et communistes a aussi démontré que l’économie constituait une arme en soi. Lancé en 1983, le projet américain « guerre des étoiles » avait pour but d’étouffer l’Union Soviétique en contraignant le politburo à mobiliser l’ensemble des ressources dont il disposait en direction du secteur de l’armement. Délaissant des secteurs fondamentaux de l’économie soviétique, les dirigeants communistes avaient aggravé la crise qui sévissait dans leur pays et affaibli davantage l’URSS face à l’Occident.
À la fin des années 1980, alors que l’Union soviétique s’effondrait, l’économie mondiale subissait une profonde mutation. Jusqu’à présent, la mondialisation restait entravée par l’existence des blocs de l’Est et de l’Ouest ainsi que par la marginalisation de nombreux pays africains, asiatiques et sud-américains. Marquée par l’hyperpuissance américaine et par un accroissement inédit des échanges internationaux, cette nouvelle ère suggérait via le triomphe des représentations libérales, que le « doux commerce » était susceptible de pacifier durablement les relations internationales.
Toutefois, l’émergence progressive d’un monde multipolaire a engendré une confrontation d’une nature inédite entre les puissances traditionnelles et les pays émergents. Alors que les conflits armés entre États ont connu une réduction de leur fréquence, les rivalités internationales se sont déplacées dans le champ de l’économie. Souvent qualifiée par l’expression polémique de « guerre économique », cette dynamique conflictuelle n’est-elle qu’une simple compétition commerciale exacerbée ou cache-t-elle des enjeux géopolitiques plus complexes ?
Guerre économique et géoéconomique
Popularisée en France par Bernard Esambert[1], un ancien conseiller du président Georges Pompidou ainsi que par Christian Harbulot[2], la notion de guerre économique fait débat. En effet, souvent jugée par les milieux universitaires comme un concept imprécis et tapageur, la guerre économique ne serait pas une notion pertinente pour qualifier le fonctionnement actuel de l’économie mondiale. Dans son ouvrage Pop Internationalism (1997), l’économiste Paul Krugman y voit un paradigme erroné qui est imprégné par la hantise d’un manque de compétitivité :
« L’idée selon laquelle l’avenir économique d’un pays dépend en grande partie de sa réussite sur les marchés mondiaux est une hypothèse et non une évidence ; et, dans la pratique, empiriquement, cette hypothèse est simplement fausse ».
Pourtant, au milieu des années 1990, Edward Luttwak, un spécialiste américain en stratégie, a émis l’idée, à travers la « géoéconomie » que les rapports de force entre puissances se reportent désormais sur l’échiquier économique. Dans ces conditions, les États se livreraient une lutte permanente pour la conquête de nouveaux marchés, la sécurisation de leurs approvisionnements en ressources critiques, et la maîtrise des nouvelles technologies. Développée également en France par Pascal Lorot, la géoéconomie contredit une vision idéaliste de la mondialisation. Loin d’apporter la paix et la prospérité pour l’ensemble des nations, la mondialisation générerait de nouvelles dynamiques conflictuelles sur la scène internationale. S’exprimant sur ce sujet avec Yves Lacoste dans la Géopolitique et le géographe (2010), Pascal Lorot affirme ainsi que :
« La puissance d’un État découle désormais en première instance, de plus en plus, de la compétitivité et du rayonnement de son économie […] Jusqu’alors à somme positive, le libre-échange, poussé dans ses retranchements les plus ultimes par une concurrence planétaire davantage exacerbée, est de plus en plus perçu comme un jeu à somme nulle, où gagner une part de marché revient, de fait, à éliminer son adversaire ».
Cependant, Pascal Lorot[3] se refuse d’assimiler la géoéconomie au concept de guerre économique. Si ces deux paradigmes sont liés par l’idée que la mondialisation génère des formes de conflictualités industrielles, commerciales, financières et monétaires, cet expert considère que les pratiques géoéconomiques ne concernent que les États.
À l’inverse, pour Christian Harbulot, la guerre économique est une notion plus englobante car elle implique à diverses échelles les États, les entreprises, la société civile, les ONG ou encore « l’infosphère ».
Une nouvelle forme de mercantilisme ?
Au-delà de leurs nuances respectives, la géoéconomie et la guerre économique alimentent les débats entre les promoteurs du libre-échange et les défenseurs du protectionnisme. Se faisant le relais en France des thèses de Paul Krugman, l’économiste Élie Cohen[4] ne voit dans la guerre économique qu’une représentation néo mercantiliste du commerce international :
« Il y a un vieux fond mercantiliste en France qui tend à voir dans les querelles commerciales l’ombre portée de la guerre économique, voire de la guerre par d’autres moyens. C’est une vision erronée des choses […] pour l’essentiel, les échanges sont affaire d’avantages comparatifs, de croissance et de développement. Pour éviter que les conflits ne dérapent nous avons créé après-guerre des autorités internationales de régulation. ».
Selon les partisans du libre-échange, la guerre économique est une aberration car elle ralentirait la création de richesses en entravant le mécanisme des échanges internationaux. De plus, selon eux, le défi principal posé par la mondialisation ne se trouverait pas au niveau de la compétitivité mais plutôt dans un rendement accru de la productivité. Chaque pays doit ainsi mobiliser ses ressources humaines, financières et scientifiques pour produire mieux et moins cher que ses concurrents.
Dans cette logique, le commerce international ne donnerait pas lieu à une guerre économique mais plutôt à une concurrence commerciale agressive l’« hypercompétition ». Pour certains spécialistes, tels que l’universitaire Fanny Coulomb, la notion de guerre économique relèverait donc de l’abus de langage :
« L’utilisation largement répandue du concept de guerre économique au cours de ces dernières années a servi à traduire l’exacerbation de la concurrence économique internationale dans le cadre de la mondialisation, avec la multiplication de stratégies offensives sur les marchés extérieurs menées par des États et des entreprises, et pouvant impliquer l’utilisation de mesures « déloyales » contraires aux principes de la concurrence. » Pour autant, ce concept ne suffit pas à retracer l’ensemble des caractéristiques de l’économie mondiale contemporaine. En outre, son emploi peut paraître abusif, le terme de « guerre » relevant d’une logique de destruction contraire à la logique commerciale ».
Pourtant, les logiques mercantiles sont insuffisantes pour appréhender les singularités de la guerre économique. Dans un monde désormais multipolaire, les États occidentaux et émergents sont engagés dans une lutte acharnée pour imposer leur influence sur la scène internationale. De ce fait, l’économie ne sert plus seulement de soutien à la puissance militaire mais elle est un pilier essentiel du « soft power ». Dans ces conditions, les puissances peuvent avoir recours à des opérations d’espionnage et de déstabilisation pour défendre leurs intérêts économiques ou atteindre ceux de leurs adversaires. La notion de « guerre économique » reflète donc les évolutions récentes des équilibres mondiaux et des modes d’expression de la puissance mais elle ne saurait constituer une grille de lecture exclusive dans l’étude des relations internationales.
Alexandre Depont
[1] Bernard Esambert, La guerre économique mondiale, Paris, Olivier Orban, 1991.
[2] Co-auteur avec le Général (cr) Pichot-Duclos, de l’article Le faux débat sur la guerre économique, revue de Défense Nationale, mai 1995.
[3] Pascal Lorot (dir.), Guerre et économie, Paris, Ellipses, 2003.
[4] Élie Cohen, « La guerre économique n’aura pas lieu », CNRS Thema, Guerres et paix, n°2 – 2ème Trimestre 2004.