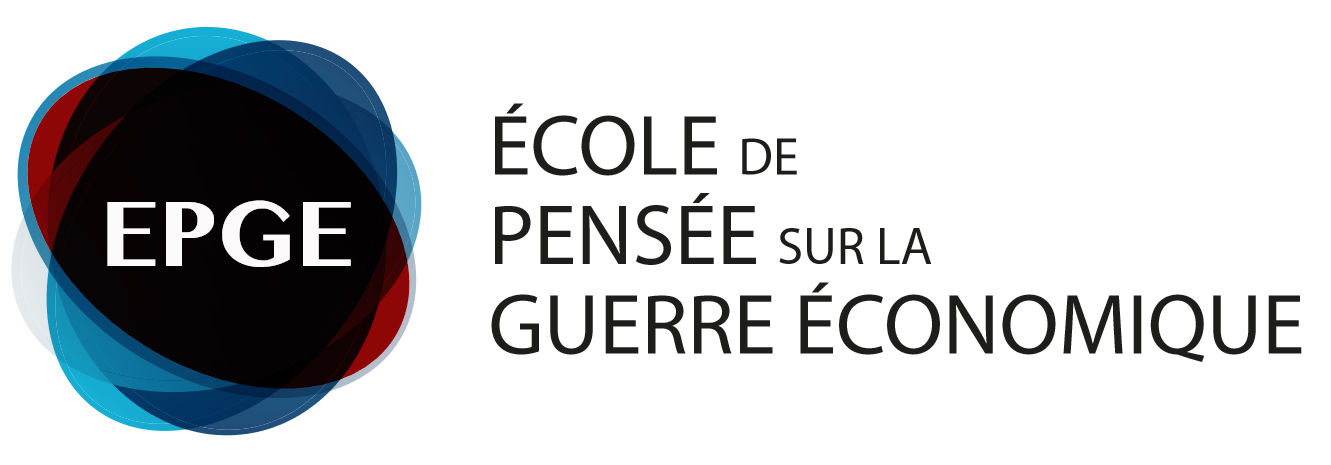Par Guiseppe Gagliano
(Cestudec Centre d’études stratégiques)
Le char européen comme mirage stratégique
Au cœur de la rhétorique européenne sur l’autonomie stratégique se niche un paradoxe jamais résolu : l’idée qu’une puissance industrielle puisse naître d’un pacte entre États inégaux en vision, intérêts et ambitions. Le podcast du CR451 de l’École de Guerre Économique nous guide dans une autopsie minutieuse d’un énième cadavre annoncé : le projet MGCS (Main Ground Combat System), le futur char de combat européen signé franco-allemand. Mais le titre, provocateur et révélateur — « Les Allemands vont-ils encore nous rouler dessus ? » — suggère déjà que l’intégration n’est souvent qu’une forme édulcorée de domination économique.
Le char Léopard : le marketing l’emporte sur la souveraineté
Le Léopard n’est pas un char. C’est un système. C’est l’axe central d’une stratégie commerciale construite avec méthode et continuité : exportation, fidélisation, club d’utilisateurs, standards partagés. Depuis 1945, plus de 13 000 chars allemands vendus dans le monde. Un chiffre qui ne dit pas tout, mais suggère beaucoup : les Allemands ont créé une chaîne d’approvisionnement européenne et une communauté d’utilisateurs qui financent collectivement la recherche, les mises à jour et l’interopérabilité. Une sorte d’OTAN du chenillé.
Derrière, il y a Rheinmetall, Krauss-Maffei, mais surtout la Bundeswehr et l’État allemand. Non pas en tant qu’acheteur, mais en tant que promoteur industriel. La machine Léopard est une machine politico-commerciale. Elle fonctionne, résiste, évolue. Et s’imposer.
Le char Leclerc : anatomie d’un traumatisme industriel
Le Leclerc, char raffiné et innovant, incarne l’inverse : l’isolement. Né sous le signe de la souveraineté, il est mort dans le silence de la marginalité. Des contrats mal négociés, comme celui avec les Émirats arabes, ont laissé un héritage de méfiance. Les prototypes dysfonctionnaient. Les légendes sur son échec technique, amplifiées par le mécontentement interne, ont créé un tabou stratégique : l’impossibilité, en France, d’investir à nouveau dans le char comme plateforme centrale.
Le Leclerc n’a pas été qu’une déception technique. Ce fut un effondrement psychologique. Une blessure culturelle. Et, comme tout traumatisme non surmonté, il s’est traduit en paralysie.
KNDS, Rheinmetall et la guerre silencieuse
KNDS — la joint-venture franco-allemande entre Nexter et Krauss-Maffei — devrait symboliser la réconciliation entre deux cultures industrielles. Mais la réalité est autre. Rheinmetall, géant autonome, contourne KNDS et propose le Panther (KF-51), un char développé sur fonds propres, prêt à l’exportation. Pendant que la France attend 2040 pour produire un nouveau char, l’Allemagne exporte dès aujourd’hui.
L’asymétrie devient stratégique. Le partenaire allemand n’abandonne rien sans contrepartie. La logique est celle de la conquête, non du compromis. Et l’État allemand soutient cette logique.
Paris-Berlin : deux visions, une débâcle
La France parle de « défense européenne », l’Allemagne de « défense de l’Europe ». Une question de sémantique ? Non : une idéologie. Les Français imaginent une industrie partagée pour s’émanciper de l’OTAN. Les Allemands consolident une filière industrielle pour dominer le marché européen, en synergie avec l’OTAN.
Derrière, deux doctrines militaires divergentes : pour Berlin, le char est la colonne vertébrale de la dissuasion conventionnelle. Pour Paris, c’est un outil flexible pour les théâtres extérieurs. Là encore : deux visions, une débâcle. Chaque tentative de convergence se brise sur la réalité des budgets, des calendriers, des marchés.
Sans intellect, sans industrie : le grand vide de l’État stratégique
La France manque de ce que l’Allemagne possède en abondance : un État qui pense, analyse et guide l’industrie. Le projet « Diamant », censé structurer l’intelligence économique dans le secteur de l’armement, a échoué avant même de naître. Les parlementaires n’écoutent pas. Les ministères ne lisent pas. Les industriels français ne font pas système. Pire : ils se coexistent. Et l’État, au lieu de jouer les médiateurs, se retire.
La défense comme tabou : ONG, ESG et paralysie démocratique
En France, produire des armes est plus stigmatisé que vendre de la pornographie. Les normes ESG imposées par les banques, les pressions des ONG financées par des fondations anglo-saxonnes, la culpabilisation morale du secteur… tout converge vers une forme d’auto-immunité nationale. L’industrie de défense n’est pas soutenue. Elle est tolérée. Quand elle est nécessaire.
La guerre en Ukraine at-elle réhabilité le char d’assaut ? Peut-être. Mais elle n’a pas effacé vingt ans d’autodénigrement. Et tant que les ONG influencent les politiques publiques plus que les think tanks stratégiques, la défense reste une exception moralement suspecte, et non un pilier de l’intérêt national.
La souveraineté mutilée : de la politique des vitrines à l’économie de la soumission
Le véritable drame du MGCS n’est pas seulement son possible échec. C’est ce qu’il révèle : un pays qui a peur de lui-même, qui délègue sa puissance industrielle par manque de courage politique. Chaque coopération franco-allemande dans le domaine terrestre finit par devenir allemande. Non par ruse berlinoise, mais par inconsistance parisienne.
Sans politique industrielle. Sans centre de promotion. Sans structure d’intelligence. Sans exportation coordonnée. La France s’illusionne en pensant pouvoir survivre avec le Rafale et le canon César. Mais ce n’est qu’une survie. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se finance, s’organise, se défend.
De la cuirasse à la pensée stratégique
La leçon est brutale. Les Allemands ne nous « écrasent » pas parce qu’ils sont plus forts. Ils nous « passent dessus » parce que nous nous retirons. Le char MGCS sera allemand ou ne sera pas. Et la France, si elle ne veut pas vivre quarante années supplémentaires de rapports, de douleurs et d’auto-flagellation, devra choisir : soit redevenir une puissance pensante, soit renoncer définitivement à la cuirasse. Et à la souveraineté qu’elle symbolise.